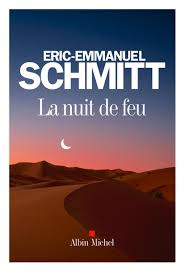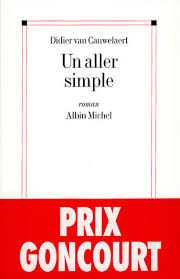Je retrouve dans ce magnifique roman le John Irving de "L'oeuvre de dieu, la part du diable". Tous les ingrédients y sont présents : l'absence du père, la Nouvelle Angleterre, la lutte - comme sport bien sûr - la ville de Vienne et cette fois-ci les ours se cachent dans un bar pour homosexuels (je devrais dire LGBTQ après la lecture de ce livre).
Aux dires d'Irving lui-même, c'est un roman sur "la difficulté d'être tolérant, réellement tolérant, à l'égard de toutes les identités sexuelles". (vidéo). Ce roman nous prouve que l'auteur y réussit et amène son lecteur à le devenir.
Mais ce n'est pas un manifeste ni une liste de revendications. Non, c'est un vrai roman, un de ceux qu'on ne lâche pas. Irving nous raconte, à la première personne, l'histoire du jeune Bill qui souffre d'"erreurs d'aiguillages amoureux".
"- Parlons franchement qu'est-ce qui t'intéresse vraiment chez toi, Bill ? me demanda Richard.
- Je ne sais pas pourquoi j'ai des... béguins soudains, inexplicables, lui répondis-je.
-Oh, des béguins... ça ne fait que commencer, dit-il pour m'encourager. Les béguins, c'est très courant, il ne faut pas que ça t'étonne d'en avoir - il faut même en profiter ! ajouta-t-il.
- Parfois, on se trompe de personne, hasardai-je
- Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais béguin, Bill, m'assura-t-il. Un béguin, ça ne se contrôle pas, ça vous tombe dessus, voilà tout.
Avec mes treize ans, j'en conclus sans doute qu'un béguin était encore plus désastreux que je ne l'avais imaginé".
Attiré autant par les femmes d'âge mûr que par ses camarades masculins, il se réfugie dans la lecture des romans soigneusement choisis par la bibliothécaire de la ville. C'est grâce à ces romans que Bill découvre qu'il n'est pas le seul à tendre vers l'homosexualité. (Irving fait d'ailleurs une étude et une critique remarquables de "La chambre de Giovanni" de Baldwin). Mais il va lui falloir bien d'autres rencontres pour comprendre et accepter sa bisexualité.
Et comme à son habitude, l'auteur nous offre des personnages forts : la bibliothécaire qui lui demande : "Mon jeune ami, je vous prierai de ne pas me coller d'étiquette. Ne me fourrez pas dans une catégorie avant même de me connaître", le grand-père qui assume chaque année un rôle féminin dans la pièce de théâtre de l'école, le camarade aimé et haï tout à la fois, la grande amie de coeur dont il ne se séparera jamais, la mère aimante mais qui cachera toute sa vie un secret, le beau-père si compréhensif et séduisant, le père biologique qu'il ne rencontre qu'une fois, sans compter les nombreuses liaisons avec des transgenres, des travestis, des hommes ou des femmes homos ou bi comme lui.
"Et quand j'arrivai à Vienne je menais depuis deux ans la vie d'un jeune gay new-yorkais.
Cela ne voulait pas dire que je n'étais pas attiré par les femmes, elles me plaisaient toujours. Mais céder à cette attirance m'aurait semblé régresser au stade où je refoulais mon homosexualité. En outre, à l'époque,mais amis et amants gays pensaient tous que celui qui se proclame bi n'est en réalité qu'un gay qui garde un pied dans le placard".
Après une vie d'écrivain célèbre, après avoir subi la perte de nombreux amis à cause du SIDA, Bill revient dans sa ville, renoue avec la tradition familiale liée au théâtre de l'école où il enseigne désormais. Il ne se contente plus d'écrire, il s'engage dans la lutte pour la reconnaissance des droits des LGBTQ.
"Larry aurait bien ri de me voir soutenir le mariage gay, sachant ce que je pensais du mariage en général. "Mon grand champion de la monogamie", aurait-il dit pour me taquiner. Mais puisque ces jeunes gays et bi veulent se marier, je les soutiens."
Le thème est sérieux mais c'est avec bonne humeur que le sujet est traité. Un tout grand Irving à mettre dans toutes les mains et en urgence !